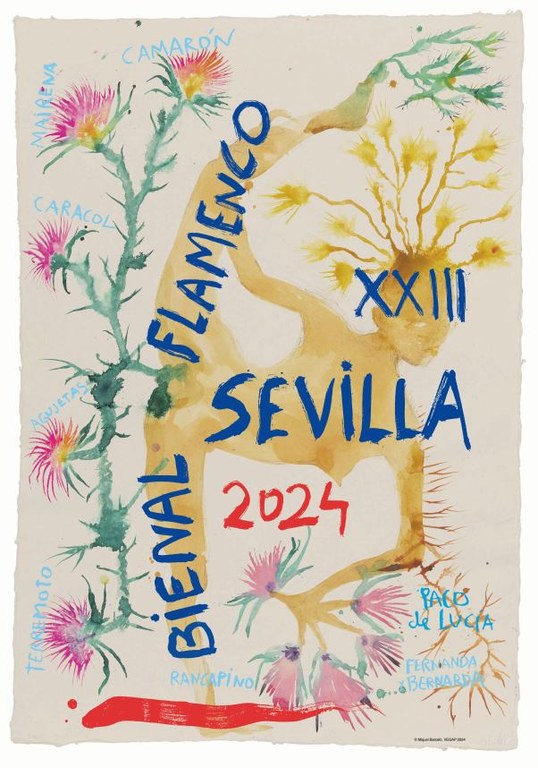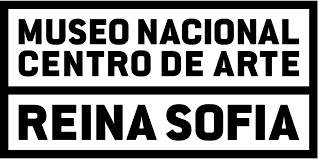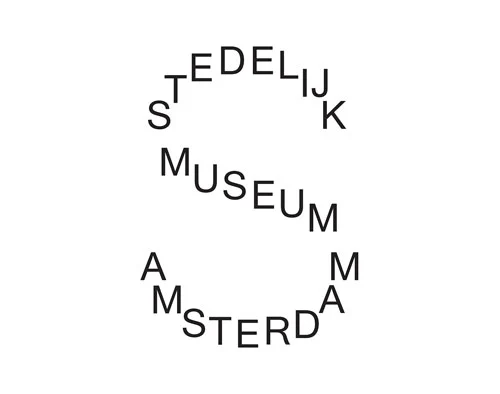« YSTERIA », UNE TRES VIEILLE HISTOIRE REMISE EN JEU

« Ysteria » texte, mise en scène et scénographie Gérard Watkins, TnBA, Bordeaux, du 7 au 16 mars, puis du 21 mars au 14 avril 2019 au Théâtre de la Tempête / Cartoucherie, Paris – coproduction TnBA.
L’hystérie a toujours fasciné les hommes (sic) sans doute parce qu’elle est grosse des traces de son origine sémantique. Dérivé du grec ὑστέρα – à traduire par matrice ou utérus – le mot est associé dans l’inconscient collectif à l’utérus féminin, cet organe fantasmé où le mystère de la vie prend naissance. Lieu tout à la fois vénéré et redouté comme menace de la puissance féminine sur l’homme qui est en dépourvu, l’utérus a été « hystérisé » d’Hippocrate à Charcot en passant par le Moyen Age. Gérard Watkins, après son très pertinent « Scènes de Violences Conjugales » – présenté sur cette même scène du TnBA en 2017 – s’empare de ce sujet, ô combien excitant, pour tenter de questionner théâtralement ce que recouvre ce mystère à jamais élucidé. Ce faisant il ouvre d’autres voies, libérant l’hystérie des rets du féminin où on a voulu la cantonner. Réussit-il pleinement dans cette entreprise « hors genre » ? Ceci est une autre histoire…
Sur le plateau des canapés aux coussins rouges qui seront remués « en tous sens » tout au long de la re-présentation sur scène de deux jeunes malades, un jeune homme et une jeune femme, atteints chacun d’hystérie dite de conversion, cette forme névrotique paroxystique où le conflit psychique, faute d’avoir pu trouver les mots pour se dire, vient s’inscrire dans des symptômes corporels prenant le relais d’une expression empêchée. Dans le cas présent, chacun d’eux souffre de paralysie partielle (poignet et bras) sans que pour autant il n’y ait trace de lésion physiologique d’un quelconque organe. Le dispositif choisi – trois psys, certes atypiques dans l’auto dérision qui les anime souvent, se relaient pour tenter de faire « accoucher » leurs patients – renvoie aux historiques leçons du mardi pratiquées par Charcot à l’Hôpital de La Salpêtrière au début du XIXème siècle. Sauf que le parterre des pairs – au rang desquels figuraient Breuer et Freud – et étudiants de l’époque, est ce soir constitué par nous spectateurs à qui on propose de prendre des notes s’il nous en chante.
D’emblée la désacralisation des psys apporte non seulement une bouffée d’oxygène euphorisante dans un contexte que l’on devine devenir rapidement chargé, mais aussi une remise en perspective des supposés savoirs de la science psychiatrique face à un mystère qui résiste. Ainsi Jean-Marc, racontant à ses deux collègues femmes l’épisode du message à l’impératif catégorique envoyé par son surmoi à l’adresse de son moi ayant instinctivement louché sur le généreux décolleté d’une jeune femme – laquelle a fort bien saisi l’intention du regard voyeur du mâle en maraude malgré les efforts dérisoires de celui-ci pour tenter de masquer la concupiscence le motivant – dans le RER qu’il vient d’emprunter, ou les insanités d’Eléonore destinées à ses jumelles qui la harcèlent, ou encore le fantasme animalier de l’ingénue Charlotte, la troisième psy. Nous sommes tous des névrosés, c’est désormais acquis. Suivra une communication théorique très pertinente sur l’hystérie de conversion visant à nous en présenter les fondements et les différentes manifestations afin que nous puissions bénéficier de cet apport de psychologie clinique pour « apprécier » les cas grandeur nature qui vont nous être exposés.
D’abord Arthur, ce jeune homme qui va se présenter devant nous comme le professeur Charcot aurait pu le faire ou encore Breuer et Freud présentant le cas d’Anna O. « Je m’appelle Arthur et je suis atteint d’une névrose de conversion ». L’événement à l’origine de son mal sans inscription physiologique – autre que la paralysie apparente qui affecte son avant-bras gauche sans qu’aucun organe ne soit lésé – il tentera sous hypnose d’en retrouver les traces sous la forme du souvenir enfoui de l’anniversaire de ses treize ans où sa main, quelques instants de rêve, était restée posée sur le sein d’une jeune fille ayant dans sa chambre retiré son T-Shirt, cette même main qui refusait obstinément depuis de lui obéir en restant « collée » à l’obscur objet du désir. Ensuite Anaïs, la jeune fille d’origine cambodgienne à la main comme anesthésiée l’empêchant de jouer toutes les notes de la partition de sa clarinette comme si une partie d’elle-même demeurait frappée de stupeur. Née de père et de mère inconnus, privée dès ses origines de la « re-connaissance » de ses géniteurs, amputée de l’assomption « initiale », elle fut placée dans un orphelinat avant d’être adoptée ; elle ne rêve depuis que d’architecture, de maisons bâties sur pilotis avec des pieux solidement fichés dans un sol mouvant, de demeures construites pour vivre en famille. Le psychodrame qui lui sera proposé en guise de thérapie verra sa belle-mère copuler allègrement avec le père de son fiancé, tandis que sa propre mère s’envoie en l’air avec le promis, elle restant abandonnée livrée à sa solitude princeps au milieu de ces/ses identités flottantes.
Au-delà des thérapies de ces deux cas d’école présentés « en direct », comme pour les mettre en abyme avec l’histoire de l’hystérie au cours des siècles, deux (très… trop) longs tableaux joués de manière volontairement outrée, vont présenter le traitement de l’hystérie par Hippocrate et Asclépios au temps des Grecs et Romains – faire éternuer les femmes pour détendre leur utérus – et le sort réservé au Moyen Age aux hystériques, sorcières possédées par le diable, et devant être à ce titre lynchées et brûlées vivantes tant elles étaient coupables de la débandade des hommes.
Gérard Watkins avec sa troupe la Perdita Ensemble reste fidèle à son processus de création faisant large place à l’écriture de plateau avant d’en fixer le contenu. De même, il aborde une fois de plus un sujet sociétal non consensuel avec l’engagement et l’exigence qui le caractérisent, et renverse le concept de l’hystérie féminine pour l’étendre non sans à-propos à l’humaine condition « en tous genres » soumise aux répressions tentaculaires des sociétés totalisantes. Cependant, le spectacle-performance proposé, s’il contient des moments expressifs fort convaincants, s’il est mû par un objectif questionnant des plus intéressants, se perd à plusieurs reprises dans des longueurs un peu lourdes qui au lieu d’étayer l’ensemble l’appesantissent inutilement – à notre point de vue certes, car comme le disent de l’hystérie de conversion les trois psys sur le plateau en jouant aux fléchettes, in fine « on n’en sait rien, de toute façon ».
Yves Kafka

Photo Pierre Planchenault