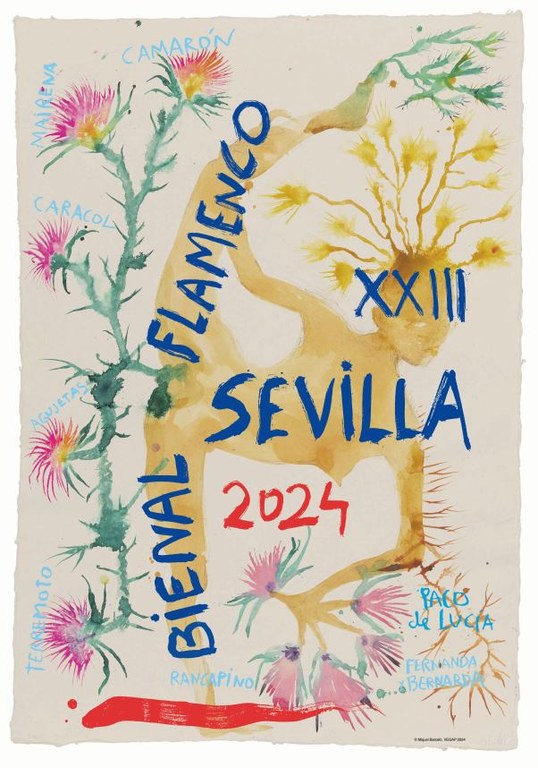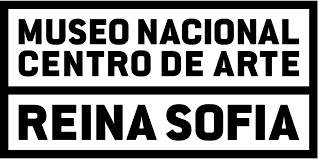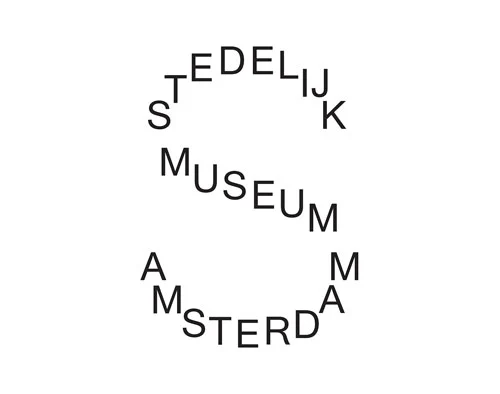INTERVIEW : ALEXANDRE ROCCOLI POUR « WEAVER QUINTET »

INTERVIEW Alexandre Roccoli – » Weaver Quintet » – Alexandre Roccoli – le 26 février à 20h30 au théâtre Benoît XII, dans le cadre du 40ème Festival Les Hivernales, Avignon.
Accueilli à la quarantième édition des Hivernales, Alexandre Roccoli a présenté sa création de 2017 : « Weaver Quintet ». Celle-ci fait suite à « Empty picture » (2013), « Longing » (2014) et « Weaver Raver » (2015), série de recherches plastiques et chorégraphiques sur des gestes artisanaux anciens. Aidés par les témoignages de ceux qui perpétuent cette mémoire ouvrière, Alexandre Roccoli pose la menace de l’automatisation des pratiques dans nos sociétés industrielles. Pour « Weaver-Quintet » il entrelace les histoires personnelles et collectives de la maladie Alzheimer et du tarentulisme (pathologie propre au sud italien provoquée par la morsure d’une araignée), soignés par des danses rituelles. Alexandre Roccoli, toujours à la croisée de plusieurs pratiques artistiques, a trouvé une écriture scénique et chorégraphique percutante pour cette transmission nécessaire ! Rencontre…
Inferno : La « transe » (pour évoquer la Pizzica) est à la verticale et les soli à l’horizontal, le malade est au sol. Musique répétitive, en disque rayé pour mieux souligner l’hystérie. Expliquez-nous ce besoin d’évocation…
Alexandre Roccoli : La maladie est constamment présente dans mon travail, comme elle l’est dans la vie. Je l’ai rencontrée de manière concrète lorsque j’ai monté des projets chorégraphiques dans des maisons de retraite et des hôpitaux psychiatriques, mais je la questionne plus généralement sur le plateau, dans l’art, dans mon rapport à la création. Je ne crois d’ailleurs pas que l’on puisse créer sans se blesser. Cela me ramène aussi à mon origine sociale, à la souffrance du milieu ouvrier.
Parlez-nous de vos partis-pris scénographiques et de mise en scène…
La métaphore tisserande me permet en effet de travailler la question du nœud social, de la jonction entre les personnes, de leur articulation. Je m’intéresse particulièrement aux disjonctions, aux parasites, à ceux qui ne « filent » pas droit, que ce soit les personnes âgées, qu’on invisibilise, aux enfants autistes, aux paysannes ou encore aux « icônes » déchues. Il s’agit de pouvoir défaire un espace au plateau comme un pansement, de délier les plis des crampes mentales. Nous avons avec Rima Ben Raim et Hugo Frison mis en place un dispositif scénique frontale qui fonctionne en constante transformations au fur et à mesure que les états de corps mutent chez les danseuses et que la musique de Deena Abdelwahed saisit les âmes des danseuses et spectateurs.
Quel est votre rapport au féminisme ?
J’ai été éduqué dans un monde où les rapports entre hommes et femmes étaient très normés. Les femmes devaient attendre que leurs hommes remontent des mines, assujetties à leurs tâches de ménagères, d‘ouvrières, d’éducatrices, le tout dans un contexte pénible et violent. La force et la mélancolie de certaines, mariées par obligation ou arrangements « communautaires » (beaucoup venaient d’Italie, de Pologne, du Maroc), m’ont profondément marqué. C’est notamment grâce à leur musique et à leurs chants que je me suis émancipé de ma condition prolétaire, en m’évadant au quotidien. Plus tard, ce sont encore cinq femmes, fortes et singulières, qui m’ont construit et révélé en tant que danseur. Mathilde Monnier, Régine Chopinot ou encore surtout Ariane Mnouchkine et Hélène Cixous avec qui j’ai pu travailler pendant quatre ans au théatre du soleil , je n’aurais jamais pu acquérir les outils d’analyse et de critique qui sont les miens.
“C’est là que notre musique traditionnelle reprend son sens premier et nous apporte un remède contre les angoisses véhiculées par le monde moderne et la mondialisation”, observe encore Sergio Blasi lors de « la Notte della Taranta ». Reliez-vous, dans votre création, les maux du passé à ceux du présent ?
Nous avons joué le quintette à Galatina dans l’épicentre du Tarantisme le jour de la san Paolo et san Pietro en juin dernier invité par Andréa Carlino un professeur et chercheur en histoire, ses équipes organisé un Paolo lab. Nous avons ainsi éclaté ce quintet dans la ville comme une toile d’araignée, nous avons tissé un parcours parallèle de zones secrètes à peine visitées. Les danseuses ont vécu une experience puissante puisque leurs soli etaient en boucles devant des personnes qui visitaient une procession secrète par groupe restreint dans un rapport très proche.
Je crois que ce que le rôle des mass-médias et des social-médias troublent certaines connections sensibles et véhiculent une série de dissociations du rapport aux corps.
L’évanescence du corps par la virtualité, par les manques de reconnections brisent ces partages du sensible. Il s agit de retrouver cette empathie du très proche au très lointain ancestrale.
Propos recueillis par Audrey Scotto

Photos crédit Elian Bachini – courtesy Alexandre Roccoli